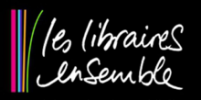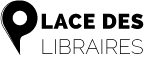- EAN13
- 9782200350086
- Éditeur
- Armand Colin
- Date de publication
- 7 novembre 2007
- Collection
- Coédition CNED/SEDES
- Nombre de pages
- 160
- Dimensions
- 24 x 16 cm
- Poids
- 231 g
- Langue
- fre
L'Empire De L'Exécutif : La Présidence Des États-Unis - De Franklin D. Roosevelt À George W. Bush, De Franklin D. Roosevelt À George W. Bush (1933-2006)
François Vergniolle De Chantal
Armand Colin
Prix public : 25,00 €
Introduction générale?>Le président des États-Unis est sans doute l'homme - ou potentiellement, la femme - le plus puissant de la planète. La montée d'une «présidence impériale », selon le titre du livre de l'historien progressiste Arthur M. Schlesinger Jr. (1917-2007) est de ce point de vue un enjeu qui concerne non seulement l'Amérique, mais aussi le reste du monde1. Le contexte actuel de « guerre contre le terrorisme » n'est que l'illustration la plus récente de ce phénomène. L'expansion considérable des pouvoirs du président en réaction aux attentats du 11/09 – toujours décrits aux États-Unis comme des « attaques » - affecte aussi bien l'équilibre interne des institutions du pays que la situation internationale. Jouer la carte de la politique extérieure pour effacer des difficultés au niveau intérieur n'a rien de nouveau. Mais c'est particulièrement visible dans le cas d'un pays comme les États-Unis qui est au centre de l'ordre international. Le président George W. Bush a recours à une recette vieille comme le monde quand il utilise la lutte contre le terrorisme à l'échelle mondiale pour cultiver la crainte de ses concitoyens et ainsi pallier les critiques contre la guerre en Irak. L'élection présidentielle de 2004 s'est d'ailleurs largement jouée sur ce sentiment de peur2. Les conséquences de cette tactique, certes grossière mais toujours efficace, se ressentent dans le monde entier. On le voit: la politique intérieure américaine et la politique internationale sont ainsi étroitement liées. Comprendre les logiques à l'œuvre au sein de la présidence américaine permet donc de décrypter également des décisions qui nous affectent directement en Europe. Quelles sont ces logiques ? La première d'entre elles est historique et paradoxale : la faiblesse initiale de la présidence. Contrairement aux pays européens, l'Amérique s'est construite politiquement sur la méfiance du pouvoir, et plus précisément, sur le rejet de sa concentration. Les premiers Européens arrivant en Amérique du Nord étaient le plus souvent des minorités - religieuses - qui eurent à subir les foudres de pouvoirs monarchiques. Les Puritains et la Couronne d'Angleterre sont ici emblématiques. La guerre d'Indépendance accentua encore cette réaction spontanée chez les colons. Les institutions politiques de la jeune république furent donc construites sur un modèle d'équilibre des pouvoirs - les checks and balances (poids et contrepoids) théorisés par James Madison, le père « intellectuel » de la Constitution, dans Le Fédéraliste n° 10 et n° 51 - afin d'éviter toute concentration ou centralisation du pouvoir sur le modèle des pays européens. Chez les Américains de l'époque, le modèle britannique - centralisation, aristocratie, monarchie, armée permanente (standing army), industrialisation, impôts élevés - constituait le type même de la décadence à l'européenne qu'il fallait éviter à tout prix. Le « sens commun » politique, tel que Thomas Paine entreprend de le présenter dans son pamphlet de 1776, repose sur l'intuition précisément inverse : décentralisation, républicanisme égalitaire inspiré des idéaux de l'Antiquité classique, milices citoyennes, agriculture et libre commerce, impôts faibles. Mais une fois l'indépendance acquise en 1783, l'idéal républicain s'avère peu propice à l'établissement d'institutions stables et efficaces. Le mouvement nationaliste des années 1780 - dit « fédéraliste » - réussit finalement à obtenir la réunion d'une convention chargée de réfléchir à la réforme des institutions. Réunie à Philadelphie au cours de l'été 1787, cette convention présente un projet qui n'a rien d'une réforme mineure. Le texte auquel aboutirent les 55 délégués, très majoritairement fédéralistes, était en effet un système tout à fait novateur et ambitieux. En particulier, les rédacteurs de la Constitution - les « Framers» - ont tenté de concilier des valeurs républicaines et un pouvoir exécutif fort. Ils ont ainsi rejeté l'héritage de la période révolutionnaire où un Congrès surpuissant était la seule institution continentale. Plus rien de tel n'existait dans le projet de Philadelphie : trois institutions distinctes étaient mises en place. Un titulaire officiel de l'exécutif était établi. Lors des débats pour l'adoption de ce projet, entre l'automne 1787 et le printemps 1788, les opposants au nouveau texte défendirent les États fédérés contre la création d'un pouvoir central fort dans lequel ils voyaient une reconstitution de la tutelle monarchique de la Grande-Bretagne, dont les Américains venaient justement de se débarrasser. Mais ces « antifédéralistes » avaient aussi à cœur de dénoncer les menaces contenues, selon eux, dans chacune des nouvelles institutions. La présidence, en particulier, portait des stigmates monarchiques qui étaient un véritable anathème. Finalement ratifié par neuf États, et officiellement en vigueur au printemps 1789, le nouveau pouvoir central était néanmoins né dans la méfiance, voire le rejet. La présidence constituait une cible de choix pour la « gauche » de l'époque, c'est-à-dire pour les antifédéralistes se posant en défenseurs des valeurs républicaines issues de la guerre d'Indépendance. Ainsi, nulle surprise dans le fait que l'écrasante majorité des présidents pendant tout le 19e siècle, se soient montrés extrêmement prudents, réservés, voire inhibés, dans l'utilisation de leurs nouvelles fonctions. Ce fut tout particulièrement le cas pour la génération ayant connu les débats de la ratification, de George Washington (1789-1796) à James Madison (1809-1817) en passant par John Adams (1797-1801) et Thomas Jefferson (1801-1809)3. Cette méfiance initiale s'estompe au 20e siècle, mais est toujours présente, comme l'illustrent le choc du Watergate en 1974 et la critique actuelle de l'équipe de G. W. Bush.