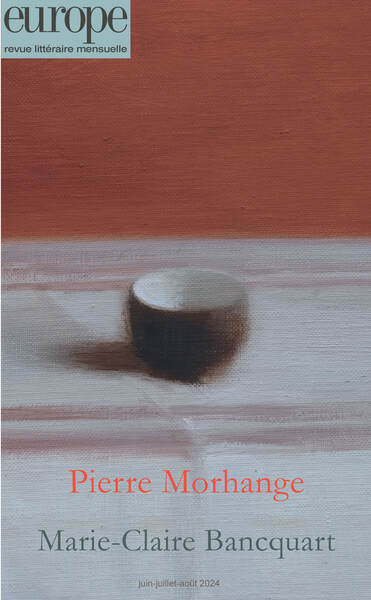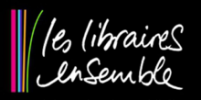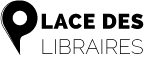- EAN13
- 9782351501382
- Éditeur
- Europe
- Date de publication
- 6 juin 2024
- Collection
- REVUE EUROPE
- Nombre de pages
- 368
- Dimensions
- 20,9 x 12,9 x 2 cm
- Poids
- 410 g
- Langue
- fre
Pierre Morhange / Marie-Claire Bancquart, 1142-1143-1144 Juin-Juillet-Août 2024
Luc Boltanski, Gérard Macé, Jean Frémon, Aude Préta-De Beaufort
Europe
Prix public : 22,00 €
<p data-mce-fragment="1"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;" data-mce-fragment="1">Pierre Morhange</span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;" data-mce-fragment="1"> (1901-1971) est un poète considérable dont il ne subsiste plus qu’une légende parmi les jeunes générations. Non pas un poète maudit, mais un poète à l’écart, étrangement et scandaleusement occulté. Son œuvre est devenue pour une large part introuvable. Pourtant, à qui n’aurait pas lu La vie est unique (1933) ou Le Sentiment lui-même (1966), il manquerait l’un des maillons du langage et de la poésie de notre temps. Avant même de se révéler comme poète, Pierre Morhange fut dans sa jeunesse l’animateur de revues importantes : Philosophies (1924-1925), L’Esprit (1926-1927) et La Revue marxiste (1929). Il eut alors pour compagnons Norbert Guterman, Georges Politzer, Henri Lefebvre, Georges Friedmann et Paul Nizan. Révoqué de son poste de professeur de philosophie sous Vichy, frappé par la censure, traqué par la Gestapo, il entra dans la Résistance et vécut dans l’illégalité. En son temps, Paul Éluard avait salué la poésie de Pierre Morhange en laquelle il voyait « l’une des clés de l’avenir ». C’est une poésie qui ne ressemble à nulle autre. À la fois âpre et nue, tendre et blessée, elle nous atteint avec la force d’un heurt physique. Une ironie aiguë s’y cache, mais aussi le rêve puissant d’un écorché vif qui reste fier et digne, livrant à peine le secret de l’infinie douceur de son amour. « Chaque livre de Morhange rend ses lecteurs furieux, heureux, sages et fous, modestes et remplis soudainement d’une ambition, d’un enthousiasme lyrique et politique dépassant toute cause », écrivait naguère Franck Venaille. Le temps est venu de rendre sa place à Pierre Morhange, au premier rang.</span></p><p data-mce-fragment="1"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;" data-mce-fragment="1"> </span></p><p data-mce-fragment="1"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;" data-mce-fragment="1">Pour Marie-Claire Bancquart (1932-2019), la poésie ne peut être ni pur jeu verbal ni lyrisme débordant. Chez elle, l’exigence formelle ne connaît pas de relâche. Cela sans doute parce qu’une telle exigence n’est pas dissociable d’une recherche de justesse (et si l’on veut de justice) : l’obsession de la mort, la révolte et le refus, l’amour de la vie confronté au malaise de vivre, l’exploration de l’intime étrangeté du corps, le désir de rejoindre les grandes circulations élémentaires, l’amour, les amitiés et la douleur de devoir les perdre un jour, la caresse, la tendresse pour une herbe minuscule, le moindre animal, l’écoute de la simplicité quotidienne, le questionnement et l’inquiétude inapaisée — tous ces « passages » si caractéristiques de l’œuvre accompagnent la quête, par les mots, d’un lieu habitable ici et maintenant. Lieu habitable qui est aussi un lieu juste où l’humain ne domine plus mais co-existe, <span style="mso-bidi-font-style: italic;" data-mce-fragment="1">compatit</span> dans l’impermanence et l’inquiétude du vivant. </span></p>