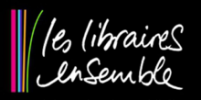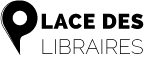- EAN13
- 9782365124126
- Éditeur
- Croquant
- Date de publication
- 11 janvier 2024
- Nombre de pages
- 188
- Dimensions
- 23 x 16 x 1 cm
- Poids
- 289 g
Revue Savoir/Agir N° 61-62, Les Usages Sociaux De L’Anglais. Diffusion De L’Anglais Et Recompositions Des Capitaux Par L'International
Collectif
Croquant
Prix public : 10,00 €
Les travaux contemporains sur les classes sociales en Europe, mêlant étroitement objectivation de la structure sociale, sociologie de la culture et sociologie de l’éducation, ont suggéré la centralité des ressources cosmopolites dans la reproduction des inégalités sociales et dans l’exercice de la domination symbolique qui soutient les dominations économique et politique1. L’acquisition de ressources internationales apparaît aujourd’hui comme une source de légitimité décisive pour accéder à des positions de pouvoir à l’intérieur des frontières nationales et au-delà2.
Pourtant, rares sont les travaux sociologiques contemporains en France qui objectivent finement le maniement de la langue anglaise, langue transnationale dominante et composante essentielle de ces ressources cosmopolites. L’anglais s’est en effet progressivement imposé comme langue mondiale, utilisée dans les échanges entre nationalités très différentes3. Dès l’accélération de sa diffusion en France au cours du dix-neuvième siècle, les formes de son apprentissage sont variées, hiérarchisées socialement et font l’objet de luttes4. Le faible niveau d’anglais supposé des Français, rengaine principalement portée par les réformateurs scolaires souhaitant adapter le système d’enseignement au marché du travail, alimente depuis plus d’un siècle et demi des débats récurrents sur son enseignement. Si cette déploration perdure, elle obscurcit plusieurs dynamiques historiques qui sous-tendent les évolutions des formes et des usages de l’anglais dans l’espace national : l’intensification des usages de l’anglais du fait de son statut de langue transnationale dominante, la réalité d’une distribution socialement très inégale de la maîtrise de cette langue, le déplacement du centre de gravité de l’espace social comme du système d’enseignement vers le pôle économique où les demandes de maîtrise de l’anglais sont vives, ou encore l’exacerbation de la concurrence scolaire et de la compétition entre grandes écoles, qui tendent elles aussi à accroître l’importance accordée à la maîtrise de cette langue. L’anglais et ses usages sociaux constituent donc un point d’entrée empirique fécond pour interroger les recompositions de l’espace social que produit la montée en puissance des ressources internationales dans les pratiques et les représentations nationales.
Face au paradoxe de la centralité de ce fait social comme du caractère heuristique de cet objet sociologique, d’une part, et du peu de travaux qui s’y confrontent directement, d’autre part, nous avons cherché avec ce dossier à susciter et à réunir des productions qui interrogent les usages sociaux de l’anglais dans des univers variés. Nous avons pour cela « passé commande » à des sociologues dont nous imaginions que les enquêtes empiriques pouvaient avoir croisé la question de l’anglais sans forcément l’avoir traitée de front. Nombreux et nombreuses sont les sociologues qui nous ont répondu qu’en effet, la question n’avait pas été prise à bras le corps au moment de l’enquête ou dans l’écriture, même si, rétrospectivement, elle apparaissait bien comme un enjeu important des mondes sociaux qu’elles et ils avaient étudiés. Certain·es ont accepté de retravailler en ce sens leurs matériaux d’enquête pour ce numéro et nous espérons que le caractère fécond de cette démarche inspirera de nouvelles enquêtes afin de compléter l’esquisse que ce dossier propose.
Les usages sociaux de l’anglais
L’historien néerlandais Willem Frijhoff propose de considérer l’usage d’une langue comme une pratique culturelle dans une société donnée5. Cela implique de définir la totalité des positions qu’une langue peut adopter dans le jeu social, c’est-à-dire l’ensemble des situations dans lesquelles la langue en question peut jouer un rôle signifiant, soit en tant qu’instrument de communication, soit en tant que symbole d’autres valeurs qui renvoient à l’histoire de cette langue ou à la position réelle ou présumée de celles et ceux qui la pratiquent. À rebours du sens commun qui ne voit dans le recours à une langue qu’une fonction véhiculaire (de communication), ce dossier insiste sur les fonctions conjointes de sélection sociale et de distinction que remplit la maîtrise de l’anglais. Enfin, les articles soulignent les visions du monde qui voyagent dans la soute de cette langue avec laquelle les agents sociaux font bien plus que « communiquer ».
La sélection par l’anglais
Un premier usage de l’anglais se trouve dans la fonction de sélection qui lui est de plus en plus assignée, que ce soit à l’entrée des formations prestigieuses ou de certains secteurs professionnels : cet impératif est aujourd’hui assimilé par certaines familles.
L’article de Marie-Pierre Pouly en début de dossier dresse un espace social de l’anglais, qui permet de comprendre où il est parlé en partant de la façon dont il est appris selon les fractions de classe. Ce sont dans les familles particulièrement dotées, d’abord en capital économique mais aussi en capital culturel, que les stratégies éducatives incluent largement l’apprentissage de l’anglais. L’étude de cas de Martine Court et Joël Laillier sur une famille de la bourgeoisie établie détaille ainsi la place socialement située de cette insistance sur l’apprentissage de la langue le plus tôt possible. Les stratégies de transmission précoce de l’anglais impliquent, pour ces familles, une variété de méthodes et une énergie considérable : consommation de produits culturels en anglais dès le plus jeune âge, voyages familiaux dans des pays anglophones, emploi de jeunes filles au pair, voire de nannies pour pratiquer l’anglais à domicile (ce que constate aussi Alizée Delpierre dans son article), scolarisation dans des écoles anglophones en France, voire expatriation dès l’enfance ou l’adolescence dans les pensionnats anglais, ou suisses, comme le souligne l’article de Caroline Bertron. Elle montre d’ailleurs que si les offres des écoles suisses étaient autant francophones qu’anglophones au début du vingtième siècle, elles sont aujourd’hui bien plus souvent anglophones en raison de la demande accrue des parents, actant la domination de l’anglais comme première langue internationale sur laquelle les familles portent leurs investissements économiques et temporels. Toutes ces stratégies d’apprentissage précoce, héritées de l’aristocratie, historiquement plutôt tournées vers l’anglais britannique, ont pour enjeu d’en faire une langue qui ne soit pas étrangère, dont le rendement scolaire soit pleinement efficace, notamment pour l’entrée dans les grandes écoles françaises, voire les établissements anglophones prestigieux et, in fine, dans les carrières professionnelles envisagées pour les enfants. Dans les classes supérieures, et notamment celles qui cumulent ressources économiques et culturelles, les compétences en anglais peuvent donc être particulièrement élevées avant l’entrée dans l’enseignement supérieur.
Au niveau des formations, cause ou conséquence de cet investissement des familles aisées et de la concurrence que se livrent les institutions scolaires pour les capter, l’anglais se transforme en outil de sélection scolaire prétendument objectif. C’est déjà la thèse de Gilles Lazuech en 1996, dans son enquête portant sur 300 écoles de commerce et d’ingénieurs, où il montrait la place de la maîtrise linguistique dans la lutte que se livraient les grandes écoles qui, pour deux tiers d’entre elles, exigeaient un niveau minimal dans deux langues étrangères pour l’obtention du diplôme6. L’obligation linguistique s’accentuait encore dans les très grandes écoles : dans 40 % d’entre elles, plus de 30 % des élèves effectuaient un séjour académique. Dans les près de trente années qui nous séparent de cette enquête, cette internationalisation s’est encore accélérée et la proportion d’étudiant·es des grandes écoles faisant un séjour à l’étranger lié aux études (stage ou séjour académique) a fortement augmenté7.
Cet impératif d’anglicisation des cursus a commencé dans les années 1960 par les écoles de commerce, comme le montre Anne-Catherine Wagner dans ce dossier, du fait de leur proximité ave...