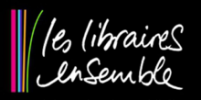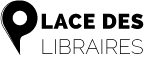- EAN13
- 9782492182235
- Éditeur
- ATLANTIQUES DEC
- Date de publication
- 23 novembre 2023
- Collection
- POESIE
- Nombre de pages
- 150
- Dimensions
- 21,5 x 11 x 1,1 cm
- Poids
- 158 g
- Langue
- fre
Anthologie De La Revue Oyapock
Crette/Rolph
ATLANTIQUES DEC
Prix public : 18,00 €
« La revue Oyapock, fondée en juin 2020 à Cayenne, a d’abord été un rêve de publications collectives. Lorsque nous ouvrons nos yeux sur le monde, nous nous voyons pluriels. Pluriels d’identités, de langues, d’histoires ou de combats, de visions. Oyapock veut refléter cette diversité. Parmi nous, autant d’auteurs d’âge mûr que de jeunes gens. Des femmes. Des hommes. Des gens qui sont dans la trajectoire d’une migration. D’autres qui sont plus installés dans l’existence. Et à tous un point communâ: la volonté, à travers l’écriture, de fonder une nouvelle dynamique littéraire, propre à l’espace contemporain caribéen-amazonien qui est le nôtre.
Les thèmes de prédilection des auteurs du collectif, sont en résonance avec notre monde contemporainâ: réalités de la migration, violences politiques et sociales, relation entre l’homme et la nature, place de la spiritualité.
Cependant, en parcourant nos textes le lecteur découvrira une polyphonie de tons et d’univers. Théâtre, poésie, nouvelles, roman, chroniques. C’est justement dans cette ouverture sur un espace complexe et à travers l’interdépendance culturelle entre ses nations que se développe la revue Oyapock. Les auteurs ne se regroupent pas autour d’une langue, d’une idée, d’une nation ou d’une histoire identique. Ils forment un réseau de discussion et d’échanges, creuset de leurs oeuvres à venir. »
Auteurs du collectif : Émile Boutelier, Nitza Cavalier, Jonas Charlecin, Sandie Colas, Alexandra Cretté, James-Son Derisier, Rossiny Dorvil, Daniel Pujol, JJJJ Rolph, Widjmy St-Vil.
Auteurs invités : Mélissa Béralus et Luis Bernard Henry,
MANIFESTE DE LA REVUE
Toute trace se signe au moment où la nuit tombe, quand la pleine lune se livre aux confins. Dans nos confins amazoniens de forêt abrupte où la trace de l’homme disparaît plus vite qu’une fiente de mouche, l’écriture – comme une sente de fourmi- existe.
Comme la dernière goutte grise de la pluie. Comme la fumée qui sort du sol humide – l’écriture existe et juste ensuite n’existe plus, incandescente et éphémère, loin du travail premier de l’écriture. Les hommes se dispersent sur des routes incertaines et complexes. La forêt océane, autour, dans un murmure assourdissant, disparaît. Nous écrivons au milieu d’un début de ruines. Au pouls d’un cataclysme fantasmé, comme au bout de nous même et aux témoins de toutes traces que nous pourrons semer. Nous avons déjà fait mille fois plus que ce que nous espérions pouvoir faire au commencement.
Nous écrirons ces mille récits d’âmes qui ne diront pas qu’elles ont raison, ou le pouvoir ou le choix. Dans un monde qui, encore une fois, s’écroule, nous écrivons les mille fleuves de sentes humaines qui jaillissent, dans un effet de lutte avec le monde. Puis de paix avec le monde, une fois le lit creusé.
Que restera t-il quand nos affres seront, avec nous, mortes?
Nous avons brûlé trois bougies noires contre d’invisibles ennemis. Contre nos peurs intérieures. Puis nous avons commencé à écrire. Et l’écriture nous a gobé dans son vaste gosier.
Lorsque nous écrivons nous partons en dérive pour faire exister, dans nos langues, une mélodie qui peut être entendue à nouveau. Traversant des milliers de miles, d’un océan à un autre. D’une rive quittée à une rive arrivée.
Nous écrivons les mille fleuves qui parcourent l’espace de toute part – ventre ouvert, déployé, féminin – joyeusement voluptueux, obscène et fécond face à la volonté de détruire.
Car tout reste à faire.
Tout reste à faire et à écrire. Au bord de nos hésitations et incompréhensions mutuelles, nous avons commencé à écrire ensemble et à devenir ce que nous ne pensions pas tous être. Nous n’avons rien eu à lisser de nous même. Rien à rendre homogène. Au contraire. Nous avons conservé l’enchevêtrement de ce qui nous échappait.
Nous écrivons en étoiles, jetons un mot à terre comme un piège-appât pour les pians. Chacun le prend et le dévore et le recrache en un poème. Nous en parlons comme d’une blague et nous passons au suivant. Souvent l’un d’entre nous nous montre combien ce que nous avons fait était beau, sans que nous le sachions vraiment.
Le langage est notre maison ouverte à tous.
Trois bougies noires contre la mort - par delà la masse de la nuit qui tombe. Nous avons déjà croisé la mort, saluée ou insultée. Au delà et entre nous, la vie fait son bruit qui nous apprend la joie, la musique et la danse, le langage du monde.
Nous avons des langues fumigènes, qui s’imposent à d’autres, qui enclavent ou réunissent. Mais nos langues nous parlent contre nous mêmes, et le temps d’un poème, d’une nouvelle, nous font abonder dans le dépassement de tout sens propre: là où nous devons aller. Là où notre sente perdure.
Trois bougies noires nous protègent, au milieu des chemins de traverse, quand l’homme est le plus grand prédateur possible.
Trois bougies noires contre le désastre du monde, posées par hasard sur le chemin de l’écriture.