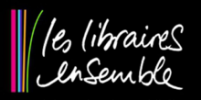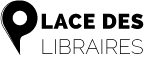- EAN13
- 9782960155921
- Éditeur
- Vies parallèles
- Date de publication
- 12 mars 2015
- Nombre de pages
- 240
- Dimensions
- 20 x 13,5 x 1,5 cm
- Poids
- 305 g
- Langue
- fre
En Marge De Casanova, Le Bréviaire De Saint-Orphée - 1
Miklos Szentkuthy
Vies parallèles
Prix public : 22,00 €
Le 4 octobre 1936, a lieu, sur la scène de l’Opéra de Budapest, la première représentation de l’Orfeo de Claudio Monteverdi, dirigé par Sergio Failoni. L’écrivain hongrois Miklos Szentkuthy, âgé de 29 ans, y assiste. Ainsi qu’aux sept représentations qui suivent. L’année suivante, il visite à Venise une grande exposition consacrée au Tintoret. Bouleversé, il revient à Budapest mais retourne derechef dans la cité lacustre en compagnie de son épouse pour l’admirer une seconde fois. Revenant plus tard sur ces expériences, Miklos Szentkuthy convint lui-même qu’elles constituèrent des tournants décisifs dans l’élaboration de ce qui allait devenir l’œuvre d’une vie, Le Bréviaire de Saint-Orphée. Décisifs et reconnaissables comme tels mais évidemment, et du propre aveu de l’auteur, pas uniques. Car le Bréviaire, opus magna dont nous entamons ici la première édition française intégrale, puise à tant de sources que les identifier toutes serait l’expérience d’une vie entière, l’exégète engageant avec le texte un pas de deux que chaque découverte viendrait relancer, inépuisablement. Jacques de Voragine, John Cowper Powys, Jérôme Bosch, Simone Weil, Charles Dickens, Jean de la Croix, les mathématiques, les dictionnaires de biologie, la poésie anglaise… Chaque pan que dissimule une partie du Bréviaire en révèle tant d’autres que rien ne paraît s’en dégager de rassembleur. Non que le plaisir de le lire en soit jamais atténué, mais cette impossibilité de lui attribuer une bannière, de le placer sous patronage, confère à ce Bréviaire, l’image d’un grand bazar, un catalogus rerum baroque. Seul resterait alors, unifiant ses maniérismes, son titre, énigmatique : Le Bréviaire de Saint-Orphée. Si la figure d’Orphée fascine, si l’on peut aisément comprendre le désir d’un poète, d’un artiste de se placer sous le patronage du mythique joueur de lyre, quel besoin de le sanctifier ? Et au-delà du besoin, n’y peut-on voir un forçage, voire presque une figure oxymorique ? Car Orphée, c’est à première vue l’exact opposé d’une religion chrétienne vécue selon ses dogmes : c’est le paganisme mâtiné d’animisme ; c’est la fièvre des corps ; c’est l’appel lascif de la musique profane. Sanctifier Orphée ? Plus encore qu’un forçage ou qu’une figure de style, c’est un blasphème ! Mais si, précisément, le blasphème n’était plus le contraire de la prière ? Si le blasphème faisait partie de la prière ? Non comme contestation interne à elle-même mais réellement comme partie prenante. En étant l’une de ses expressions sincères et profondes, en la constituant et l’achevant. Sanctifier Orphée, et donner à lire son Bréviaire, serait alors conjuguer la harpe du poète et le bâton du pèlerin. L’un ne serait plus irréductible à l’autre. Le recours au blasphème devient alors l’occasion d’un retour à ce qui fonde la prière. De même qu’on s’est beaucoup échiné à clore hermétiquement les espaces religieux et profanes, on a souvent pris le parti du corps en prétendant qu’il avait été oublié. Le même valant pour ce qu’on lui opposa de tous temps : la raison. L’opposition classe le réel – elle ne l’approche pas. Sanctifier Orphée, c’est nous rappeler que le contraire est une construction. Que l’épuisement du réel ne peut reposer sur un choix de sujets construits comme des contraires. Et qu’il convient d’en appeler à chacun de ses aspects pour embrasser la réalité dans son infinie complexité. C’est le propre de toute grande œuvre que, à défaut d’y réussir, du moins d’y tendre. Dans ces figures de Monteverdi ou du Tintoret, de Casanova ou d’Ignace de Loyola, dans cette procession de figures historiques, dans cette gigantesque et éblouissante mascarade, se dresse rien de moins qu’une des tentatives les plus géniales de dresser le monumental et fantomatique catalogue des questions. Écrire Saint-Orphée, c’est écrire qu’on se propose de saisir le réel dans sa totalité. Comme l’écrit Miklos Szentkuthy, «je suis un homme avide de réalité: je veux la voir, la toucher, la percevoir – à n’importe quel prix! – et surtout, l’exprimer dans toute sa plénitude!»